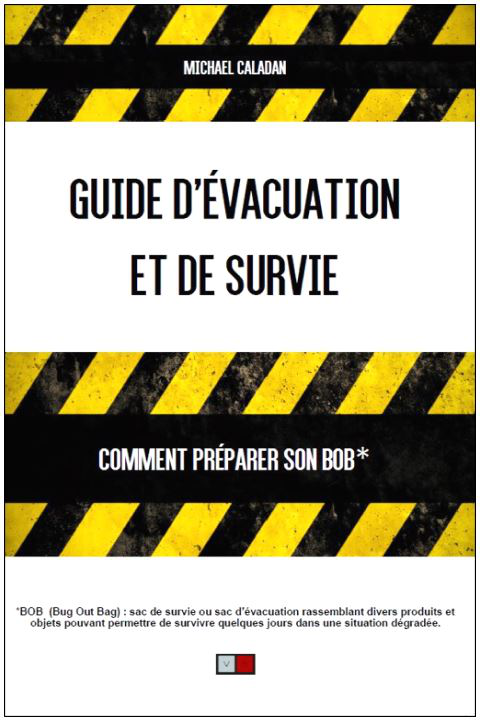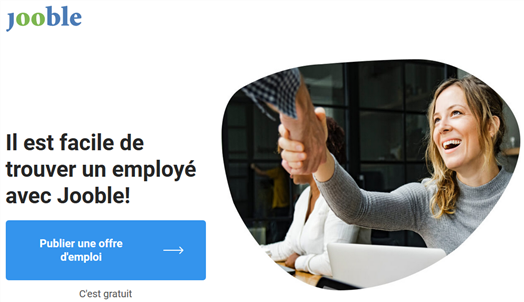Le concept de réseau revêt aujourd’hui des acceptions très différentes au confluent de la sociologie, des NTIC, de la psychologie, et de bien d’autres disciplines. Pouvez-vous nous situer brièvement l’état de la recherche en la matière ?
En sciences humaines, le réseau est d’abord issu de la théorie des graphes en mathématiques pour optimiser les flux de transport au sein des villes. Il devient ensuite une méthode sociométrique d’analyse des relations sociales pour cartographier le maillage des acteurs et déterminer le rôle social de chaque acteur en fonction de la position occupée au sein du maillage. Aujourd’hui le réseau est surtout décliné dans le domaine de la communication sur Internet, pour mieux comprendre les phénomènes de partage ou de diffusion de l’information entre des acteurs qui ne sont pas toujours proches socialement, mais qui utilisent les mêmes outils numériques.
Au début de votre ouvrage, vous décrivez le réseau comme « un îlot de cohésion sociale dans un océan d’incertitudes économiques et politiques ». Les réseaux ont donc un rôle régulateur dans notre société, semblable à celui des institutions ?
Il ne faut pas confondre institution et réseau à mon sens. Une institution régule de l’extérieur par la conformité à des normes, les comportements entre des acteurs qui ne se connaissent pas. En revanche, un réseau se construit à partir de la proximité cognitive ou affective entre des acteurs qui se connaissent. De ce point de vue, le réseau régule les comportements de ses membres de l’intérieur suivant des conventions, qui ne s’appliquent pas à l’extérieur. L’adhésion au réseau est toujours librement consentie. A l’inverse, le respect des normes institutionnelles est imposé par la loi, ou par l’arbitraire d’une autorité. Lorsque les institutions connaissent une crise de légitimité, les acteurs ont alors tendance à se réfugier dans des réseaux qu’ils construisent à leur image.
« Qui se ressemble, s’assemble », dit-on. Le partage d’un socle de valeurs communes est-il une condition nécessaire à la cohésion d’un réseau, ou peut-il y avoir de la place et de l’estime pour les antagonismes ? Quelle différence entre un réseau et du communautarisme ?
Le partage d’un socle de valeurs communes est une condition nécessaire mais pas suffisante pour former un réseau. Un réseau se construit durablement lorsqu’il parvient à maintenir un degré de diversité dans l’unité, un degré d’ouverture vers d’autres valeurs pour enrichir le tissu des relations tout en préservant la solidarité. A l’inverse du réseau, le communautarisme ne vise pas à enrichir la solidarité par l’ouverture à la différence. Il valorise le repli sur soi, en cherchant à transformer le monde extérieur à son image. Autrement-dit, ce qui distingue le réseau du communautarisme, c’est l’unité pas l’unicité !
Vous comparez, à travers une approche macro, les nations à des réseaux en prenant les exemples des Etats-Unis, de l’Italie et de la France. Quelles sont les principales différences entre ces « macroréseaux » ?
Dans chaque pays à travers le monde domine un prisme idéologique. En Italie, la population n’a pas confiance dans les institutions politiques et économiques, mais dans la famille ! Dans cette mesure, les réseaux italiens sont fédérés par le lien du sang, entre des PME familiales, ou dans des partis politiques aux ramifications généalogiques. Aux Etats-Unis, le prisme idéologique est davantage fondé sur la libre entreprise au sein de l’économie de marché. Les réseaux américains sont alors fédérés par le marché, à partir de l’expérience des transactions réussies entre partenaires. En France, le paradigme dominant est encore différent. Il ne repose ni sur le lien du sang, ni sur la transaction économique réussie, mais par l’intérêt général qui confère aux réseaux une dimension politique, voire institutionnelle. Les réseaux français sont le plus souvent fédérés autour du rôle de l’Etat.
La culture et l’histoire d’une nation permettent-ils de mieux comprendre les jeux d’intermédiation dans le cadre de la négociation à l’international, ou du management interculturel ?
Pour répondre à cette question, je vais prendre un exemple concret. Si l’on considère la question de la recapitalisation des finances publiques de la Grèce au sein de l’Union européenne, deux héritages culturels s’affrontent parmi les pays membres de ce réseau d’Etats-Nations : les nations inspirées par la culture judéo-chrétienne comme la France pour lesquelles la solidarité au sein du réseau envers les maillons faibles est un devoir moral ; les nations de culture protestante comme l’Allemagne ou l’Angleterre pour lesquelles la solidarité n’est pas un acte moral mais un acte réfléchi en fonction de la justice sociale au sein du réseau : le maillon faible mérite d’être aidé à condition qu’il ait respecté la charte des droits et des devoirs au sein du réseau. La Chine joue ainsi sur ces divisions au sein de l’Europe pour aider la Grèce, et obtenir à moindre coût une tête de pont pour pénétrer le marché unique.
Un réseau est-il plutôt efficace lorsqu’il est gouverné ou auto-organisé ? Par extension, sont-ce les économies libérales ou celles dirigées qui sont les plus propices à l’émergence de réseaux forts ?
Il n’y a pas de réponse universelle à cette question. Si l’on considère le cas de la France, la puissance économique du pays repose sur la centralisation de l’Etat pour favoriser l’éclosion de champions nationaux dans des domaines où la compétitivité repose sur des économies d’échelle : les transports, les télécommunications, l’énergie, l’eau, etc. Les réseaux sont alors gouvernés par un pilote. Néanmoins, avec la globalisation des marchés et la nécessité d’innover dans un monde multipolaire, il convient de tirer parti des liens émergents, non imposés par la puissance publique, entre des PME implantées sur des territoires à fort rayonnement technologique. Dans cette perspective, la force des réseaux repose alors davantage sur leur caractère émergent et auto-organisé, domaine dans lequel la France a beaucoup plus de difficulté à s’imposer en raison de l’héritage Colbertiste.
Les réseaux économiques territoriaux, tels les pôles de compétitivité, ont-ils encore un sens dans la mondialisation ?
La mondialisation correspond à l’ouverture des frontières des anciens pays du « bloc communiste », comme la Russie ou la Chine, à l’économie de marché. Ce faisant, l’entrée de ces nouveaux pays concurrents ravive la guerre économique avec les Etats du « bloc capitaliste » comme les Etats-Unis, le Japon ou l’Europe. Pour survivre dans cette compétition internationale, chaque pays doit se démarquer en développant des avantages comparatifs, qui se nichent au sein des territoires innovants, comme la Silicon Valley pour les Etats-Unis, la Silicon Wadi pour Israël, ou Sophia Antipolis en France. Ces territoires compétitifs présentent la particularité de bénéficier : des compétences à l’export des réseaux de la diaspora, des ressources des réseaux publics-privés et du support des réseaux de télécommunications et de transports étendus au reste du monde.
Pour développer une économie et un modèle de société efficacement « reliés », quelles sont selon vous les institutions « critiques » à préserver ?
Il est particulièrement important d’articuler la dimension économique avec l’aspiration sociale de chacun, afin d’éviter les crises de société. Pour atteindre cet objectif, il convient de laisser le marché réguler les biens privés, de confier à l’Etat les affaires publiques, et d’adresser aux réseaux publics-privés la gestion des biens hybrides à mi-chemin entre l’intérêt général et l’intérêt particulier. Cette règle de bon sens n’est pas aussi simple à tenir, lorsque la crise économique pousse l’Etat à doper la croissance par l’endettement public en prenant le risque d’ingérence dans les affaires privés, ou lorsque les entreprises cherchent de nouveaux relais de croissance sur les marchés publics avec le risque d’instrumentalisation de l’intérêt public. Dans ces conditions, pour obtenir un modèle de société économiquement viable et socialement acceptable, il faut éviter la confusion des genres entre les prérogatives de l’Etat et celles des entreprises. Il convient aussi d’accepter parfois de travailler en réseau, hors du jeu institutionnel classique, afin de gagner en efficacité.

 Éditorialistes & Contributeurs
Éditorialistes & Contributeurs Corporate management
Corporate management