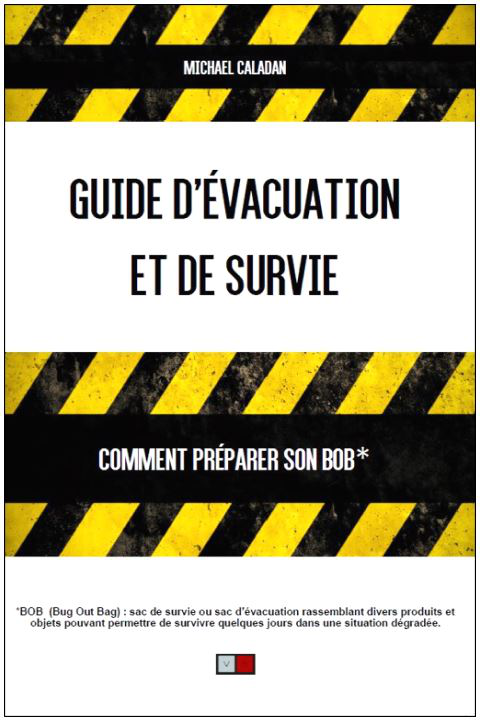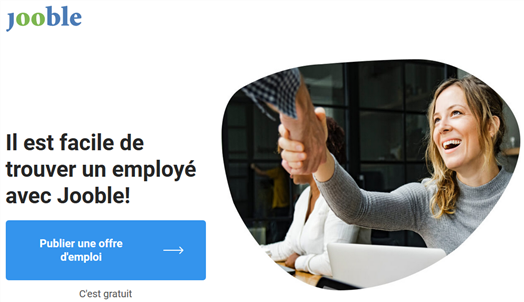Le groupe Royer, un mastodonte fragilisé
Depuis sa création, le groupe Royer s’était hissé parmi les piliers de la chaussure en France et en Europe. Implanté à Fougères, il avait su exercer une position forte dans le négoce et la distribution de marques sous licence. Or, plusieurs signaux d’alerte se faisaient sentir bien avant l’officialisation du redressement judiciaire : la recherche de rationalisation, la baisse de volumes, la restructuration d’activités. Selon le site même du groupe : « 132 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2023, dont 45 % à l’export ». De fait, même un acteur référent tel que Royer montrera sa vulnérabilité quand le modèle ne suit plus.
La procédure de redressement judiciaire reflète cette fragilité. Le média FashionNetwork évoque que « le spécialiste breton de la distribution de chaussures, basé à Fougères, s’est placé sous la protection du tribunal de commerce de Rennes ». Cette formulation souligne que Royer ne se contente plus d’un simple ajustement financier : l’entreprise entre dans une phase de protection formelle face à ses créanciers. Avec ce statut, les livraisons, les partenaires et les emplois deviennent des points de vigilance immédiats.
Les causes profondes du redressement judiciaire de Royer
Le redressement judiciaire du groupe Royer s’explique par un double effet : des difficultés structurelles anciennes et des chocs conjoncturels récents.
Sur le plan structurel, le modèle de Royer, centré sur la distribution de licences de marque, s’est heurté à des marges dégradées tandis que les coûts de fabrication, logistique et transport augmentaient. Le résultat net négatif enregistré précédemment exprimait déjà cette tension. Par ailleurs, l’entreprise revendiquait 12 millions de produits vendus par an, ce qui indiquait un volume significatif mais peut-être insuffisant pour amortir les investissements requis.
Côté conjoncturel, la baisse de la consommation de chaussures spécialisées, l’accélération de la digitalisation du commerce, la montée en puissance de nouveaux entrants à prix cassés ont confronté Royer à un horizon plus difficile. Le redressement judiciaire apparaît alors comme la réponse judiciaire à un cumul de pressions : l’endettement croissant, la trésorerie sous contraintes, et la nécessité de limiter l’hémorragie. Le groupe a d’ailleurs engagé des réductions d’effectifs et des fermetures de sites dès 2021 et 2024, confirmant que la remise à flot nécessitait des coupes significatives.
Scénarios d’avenir pour Royer sous redressement judiciaire
Entrer en redressement judiciaire n’est pas automatiquement synonyme de liquidation : cela ouvre une période pendant laquelle Royer peut tenter de redresser la barre. L’enjeu est d’abord d’assurer la continuité de l’activité tout en proposant un plan de redressement crédible. Pour ce faire, le groupe devra sans doute : réviser ses circuits de distribution, augmenter la part du e-commerce, réduire davantage ses coûts fixes, et éventuellement céder certains actifs non stratégiques.
Le redressement judiciaire ouvre également la possibilité d’un adossement industriel ou d’un rapprochement stratégique. Royer dispose d’un patrimoine de marques importantes et d’un réseau de distribution reconnu. Si l’entreprise parvient à stabiliser ses finances pendant la période d’observation, elle pourrait ressortir allégée, mais viable. Toutefois, si le plan échoue, la liquidation pourrait devenir inévitable. Le marché de la chaussure reste exigeant : seul un modèle adapté à l’ère numérique, aux chaînes logistiques performantes et aux attentes des consommateurs permettra de redonner à Royer la solidité qu’il a perdue.

 Éditorialistes & Contributeurs
Éditorialistes & Contributeurs Corporate management
Corporate management