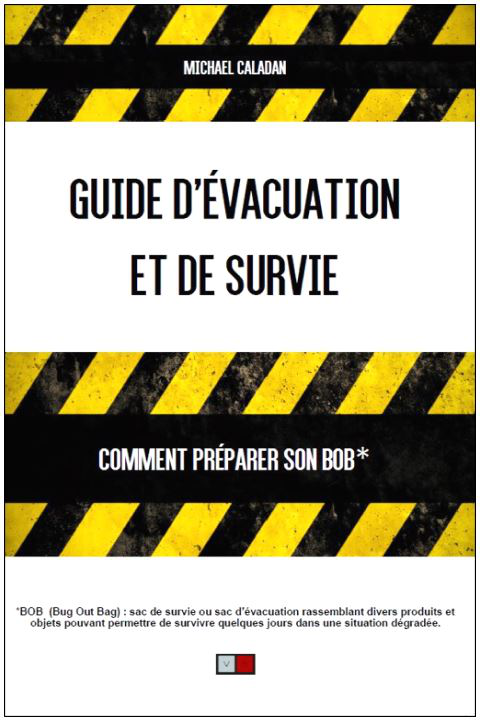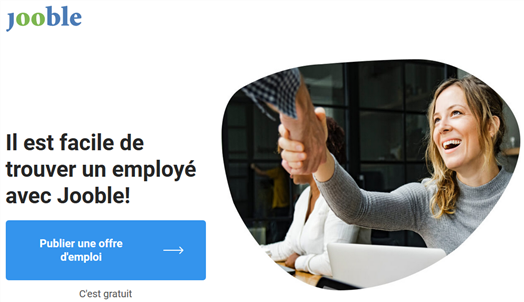Les PFAS : un élément clé de l’industrie moderne
L’Assemblée nationale s’apprête à adopter une proposition de loi visant à interdire une large partie des PFAS d’ici 2026, bien au-delà des réglementations européennes existantes. Officiellement portée par des préoccupations environnementales et sanitaires, cette initiative pourrait avoir des conséquences économiques majeures. Alors que l’industrie chimique française se retrouve en première ligne, des acteurs internationaux, notamment nordiques et américains, profitent de cette dynamique pour renforcer leur position sur le marché. Derrière la lutte contre les « polluants éternels », se joue un affrontement industriel stratégique.
Les PFAS regroupent des milliers de composés aux propriétés exceptionnelles. Leur résistance aux températures élevées et aux substances corrosives les rend essentiels dans la fabrication de produits à haute valeur ajoutée, notamment dans l’électronique, l’aéronautique et la santé. Les semi-conducteurs, utilisés dans les puces électroniques, dépendent de ces substances pour garantir des performances optimales. Dans le domaine médical, certaines prothèses et équipements de pointe ne peuvent tout simplement pas être conçus sans PFAS.
En France, plusieurs entreprises, dont certaines spécialisées dans les revêtements de surface et la chimie de spécialité, se trouvent directement menacées par l’interdiction à venir. À l’échelle mondiale, le secteur des revêtements industriels et des polymères fluorés représente plusieurs milliards d’euros, un marché dominé par des entreprises américaines et asiatiques. En interdisant ces substances avant même que des solutions alternatives viables ne soient pleinement développées, la France risque de fragiliser son industrie chimique, tandis que d’autres pays poursuivent leur production et leurs exportations.
Les PFAS regroupent des milliers de composés aux propriétés exceptionnelles. Leur résistance aux températures élevées et aux substances corrosives les rend essentiels dans la fabrication de produits à haute valeur ajoutée, notamment dans l’électronique, l’aéronautique et la santé. Les semi-conducteurs, utilisés dans les puces électroniques, dépendent de ces substances pour garantir des performances optimales. Dans le domaine médical, certaines prothèses et équipements de pointe ne peuvent tout simplement pas être conçus sans PFAS.
En France, plusieurs entreprises, dont certaines spécialisées dans les revêtements de surface et la chimie de spécialité, se trouvent directement menacées par l’interdiction à venir. À l’échelle mondiale, le secteur des revêtements industriels et des polymères fluorés représente plusieurs milliards d’euros, un marché dominé par des entreprises américaines et asiatiques. En interdisant ces substances avant même que des solutions alternatives viables ne soient pleinement développées, la France risque de fragiliser son industrie chimique, tandis que d’autres pays poursuivent leur production et leurs exportations.
Un déséquilibre dans la régulation européenne et mondiale
Contrairement aux discours alarmistes, l’Union européenne a déjà mis en place un cadre réglementaire strict. La directive REACH a interdit depuis 2006 les PFOS et a imposé en 2020 des restrictions sur les PFOA. L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) planche actuellement sur une régulation plus large, qui pourrait voir le jour en 2025, avec des dérogations pour les usages considérés comme essentiels.
Là où la France fait cavalier seul, d’autres puissances économiques adoptent une approche plus pragmatique. Aux États-Unis, la régulation des PFAS reste fragmentée, certains États comme la Californie imposant des restrictions, tandis que d’autres laissent une large marge de manœuvre aux industriels. En Chine, les PFAS de première génération, jugés les plus nocifs, sont toujours massivement utilisés dans la fabrication de textiles et de composants électroniques.
Le choix français d’une interdiction unilatérale crée donc un déséquilibre concurrentiel majeur. Les entreprises hexagonales devront se plier à des exigences plus strictes, tandis que leurs concurrents asiatiques et nord-américains continueront à inonder le marché mondial de produits contenant des PFAS. L’effet immédiat sera un transfert de production vers des zones où la législation est plus permissive, réduisant l’impact environnemental attendu en France sans limiter la pollution globale.
Là où la France fait cavalier seul, d’autres puissances économiques adoptent une approche plus pragmatique. Aux États-Unis, la régulation des PFAS reste fragmentée, certains États comme la Californie imposant des restrictions, tandis que d’autres laissent une large marge de manœuvre aux industriels. En Chine, les PFAS de première génération, jugés les plus nocifs, sont toujours massivement utilisés dans la fabrication de textiles et de composants électroniques.
Le choix français d’une interdiction unilatérale crée donc un déséquilibre concurrentiel majeur. Les entreprises hexagonales devront se plier à des exigences plus strictes, tandis que leurs concurrents asiatiques et nord-américains continueront à inonder le marché mondial de produits contenant des PFAS. L’effet immédiat sera un transfert de production vers des zones où la législation est plus permissive, réduisant l’impact environnemental attendu en France sans limiter la pollution globale.
Une offensive économique déguisée ?
Si la question environnementale est au cœur des débats, les dynamiques économiques sous-jacentes sont souvent passées sous silence. Depuis 2003, la Suède, appuyée par certaines ONG influentes comme ChemSec, milite activement pour l’interdiction des PFAS en Europe. Derrière cet engagement se cache une stratégie industrielle bien rodée. L’industrie chimique suédoise est historiquement moins développée que celle de la France ou de l’Allemagne. En poussant à une interdiction totale des PFAS, Stockholm favorise un repositionnement stratégique vers des matériaux alternatifs, où ses industriels ont une longueur d’avance.
Des multinationales nordiques comme Electrolux ont intensifié leur lobbying contre les PFAS, notamment auprès des instances européennes. Le groupe suédois, qui a longtemps cherché à imposer ses normes dans le secteur des électroménagers, s’est positionné comme un acteur majeur dans la transition vers des substituts aux PFAS. Le parallèle avec d’autres offensives économiques est frappant : la pression exercée sur l’industrie nucléaire française par l’Allemagne et les affaires de concurrence déloyale dans le domaine des sous-marins militaires révèlent un schéma récurrent.
L’Europe, en devenant un terrain de jeu pour des influences économiques déguisées en batailles environnementales, risque de voir son industrie chimique laminée par des choix réglementaires précipités. En ne prenant pas en compte cette dimension stratégique, la France s’expose à une perte de souveraineté industrielle, alors même que les PFAS restent indispensables dans des secteurs d’avenir comme la microélectronique et l’aéronautique.
Des multinationales nordiques comme Electrolux ont intensifié leur lobbying contre les PFAS, notamment auprès des instances européennes. Le groupe suédois, qui a longtemps cherché à imposer ses normes dans le secteur des électroménagers, s’est positionné comme un acteur majeur dans la transition vers des substituts aux PFAS. Le parallèle avec d’autres offensives économiques est frappant : la pression exercée sur l’industrie nucléaire française par l’Allemagne et les affaires de concurrence déloyale dans le domaine des sous-marins militaires révèlent un schéma récurrent.
L’Europe, en devenant un terrain de jeu pour des influences économiques déguisées en batailles environnementales, risque de voir son industrie chimique laminée par des choix réglementaires précipités. En ne prenant pas en compte cette dimension stratégique, la France s’expose à une perte de souveraineté industrielle, alors même que les PFAS restent indispensables dans des secteurs d’avenir comme la microélectronique et l’aéronautique.
L’impact pour les entreprises françaises
L’application stricte de la PPL aura des répercussions économiques considérables. En France, plus de 5 000 emplois sont directement liés à l’industrie des polymères fluorés et aux secteurs utilisant des PFAS dans des applications critiques. Certaines entreprises ont déjà investi dans des solutions de recyclage et de traitement des déchets contenant ces substances, prouvant qu’une gestion responsable est possible sans nécessairement interdire ces composés.
L’absence d’une approche graduelle met en péril la capacité d’innovation des industriels français. Contrairement à l’Allemagne, qui mise sur une interdiction progressive tout en soutenant activement la recherche de solutions alternatives, la France se prive de cette flexibilité. Les entreprises hexagonales, soumises à des normes plus strictes, perdront en compétitivité et devront importer des produits fabriqués hors d’Europe, sans contrôle sur leur composition chimique.
L’enjeu dépasse le cadre de la réglementation environnementale. L’interdiction généralisée des PFAS pourrait ralentir la transition écologique en pénalisant certaines technologies propres qui en dépendent, notamment les batteries des véhicules électriques ou les membranes des éoliennes. À l’heure où la France cherche à renforcer son indépendance industrielle, cette décision apparaît en contradiction avec les objectifs affichés du gouvernement.
L’absence d’une approche graduelle met en péril la capacité d’innovation des industriels français. Contrairement à l’Allemagne, qui mise sur une interdiction progressive tout en soutenant activement la recherche de solutions alternatives, la France se prive de cette flexibilité. Les entreprises hexagonales, soumises à des normes plus strictes, perdront en compétitivité et devront importer des produits fabriqués hors d’Europe, sans contrôle sur leur composition chimique.
L’enjeu dépasse le cadre de la réglementation environnementale. L’interdiction généralisée des PFAS pourrait ralentir la transition écologique en pénalisant certaines technologies propres qui en dépendent, notamment les batteries des véhicules électriques ou les membranes des éoliennes. À l’heure où la France cherche à renforcer son indépendance industrielle, cette décision apparaît en contradiction avec les objectifs affichés du gouvernement.

 Éditorialistes & Contributeurs
Éditorialistes & Contributeurs Corporate management
Corporate management