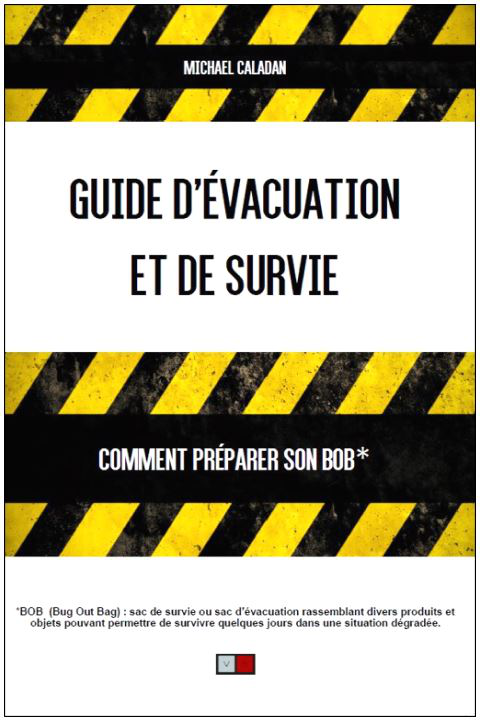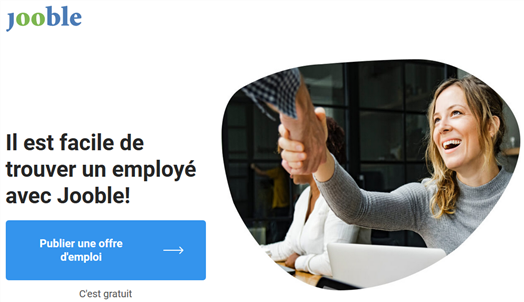Origine du litige : une offre commerciale jugée illicite par TF1
L’objet du contentieux repose sur l’offre TV+ de Canal+, qui permet à ses abonnés, contre un abonnement de 2 euros par mois, d’accéder à un bouquet de près de 80 chaînes, dont TF1, TMC, TFX et LCI. Cette offre inclut la diffusion en direct et en replay, via une interface numérique unique, à la fois sur téléviseur et via application mobile.
TF1 reproche à Canal+ d’inclure ses chaînes dans cette formule sans autorisation préalable, ce qui constituerait, selon le plaignant, une exploitation commerciale illicite de ses contenus audiovisuels. L’argument central repose sur l’absence de contrat de distribution entre TF1 et Canal+, au sujet de cette offre spécifique.
TF1 reproche à Canal+ d’inclure ses chaînes dans cette formule sans autorisation préalable, ce qui constituerait, selon le plaignant, une exploitation commerciale illicite de ses contenus audiovisuels. L’argument central repose sur l’absence de contrat de distribution entre TF1 et Canal+, au sujet de cette offre spécifique.
Les qualifications juridiques invoquées par TF1
La plainte repose sur plusieurs fondements juridiques, détaillés dans les sources consultées :
- Atteinte aux droits voisins des éditeurs audiovisuels, consacrés en droit français à l’article L.216-1 du Code de la propriété intellectuelle. TF1 considère que Canal+ rediffuse son signal sans rémunération ni autorisation, ce qui constituerait une atteinte directe à ses droits de diffusion.
- Parasitisme économique : TF1 reproche à Canal+ de tirer profit de ses investissements éditoriaux (programmes, interface TF1+, contenus exclusifs) sans supporter les coûts correspondants.
- Atteinte à la marque : la dénomination “TV+” utilisée par Canal+ serait susceptible de créer une confusion avec le service “TF1+”, marque déposée récemment par le groupe TF1, ce qui ouvre un terrain connexe sur la protection des signes distinctifs.
- Violation du règlement européen sur la portabilité : selon TF1, Canal+ rend ses contenus accessibles au Royaume-Uni, alors que la portabilité transfrontalière est strictement limitée à l’Union européenne en vertu du règlement (UE) 2017/1128 du 14 juin 2017.
La position défendue par Canal+
Le groupe Canal+ conteste l’analyse juridique de TF1 et soutient que les chaînes de la TNT sont diffusées en clair, donc accessibles librement sans nécessité de contractualisation. Cette position repose sur une interprétation extensive du principe d’accessibilité des chaînes gratuites, qui aurait vocation à s’appliquer y compris lorsqu’elles sont agrégées dans une offre commerciale non linéaire, dès lors qu’aucune barrière technique ou cryptage n’en limite l’accès.
Par ailleurs, Canal+ affirme agir en conformité avec la législation actuelle, notamment en ce qui concerne la rediffusion sur Internet de contenus diffusés en clair, à la condition que le flux original ne soit pas altéré ou modifié. Enfin, le groupe précise avoir signé des accords explicites avec France Télévisions et M6, ce qui, selon lui, établit une pratique de marché conforme aux usages dans la distribution audiovisuelle. Ce contentieux s’inscrit dans une série de différends similaires, notamment entre TF1 et Molotov, qui avait déjà conduit à une condamnation en 2022 pour des faits de diffusion non autorisée. Il illustre l’enjeu croissant que représente le contrôle des canaux de distribution numériques par les éditeurs historiques, face à la montée en puissance des plateformes intégrées, qu’elles soient gratuites ou payantes. Il pose également la question de la portée exacte des droits voisins dans un environnement numérique, notamment lorsque des chaînes gratuites sont proposées dans un cadre contractuel élargi à d’autres services audiovisuels.
L’issue judiciaire du litige opposant TF1 à Canal+ pourrait faire jurisprudence, en précisant les conditions dans lesquelles les chaînes gratuites peuvent (ou non) être intégrées dans des bouquets payants sans l’accord des éditeurs. Elle pourrait également clarifier l’application des règles de portabilité et les obligations contractuelles des distributeurs audiovisuels vis-à-vis des ayants droit.
Par ailleurs, Canal+ affirme agir en conformité avec la législation actuelle, notamment en ce qui concerne la rediffusion sur Internet de contenus diffusés en clair, à la condition que le flux original ne soit pas altéré ou modifié. Enfin, le groupe précise avoir signé des accords explicites avec France Télévisions et M6, ce qui, selon lui, établit une pratique de marché conforme aux usages dans la distribution audiovisuelle. Ce contentieux s’inscrit dans une série de différends similaires, notamment entre TF1 et Molotov, qui avait déjà conduit à une condamnation en 2022 pour des faits de diffusion non autorisée. Il illustre l’enjeu croissant que représente le contrôle des canaux de distribution numériques par les éditeurs historiques, face à la montée en puissance des plateformes intégrées, qu’elles soient gratuites ou payantes. Il pose également la question de la portée exacte des droits voisins dans un environnement numérique, notamment lorsque des chaînes gratuites sont proposées dans un cadre contractuel élargi à d’autres services audiovisuels.
L’issue judiciaire du litige opposant TF1 à Canal+ pourrait faire jurisprudence, en précisant les conditions dans lesquelles les chaînes gratuites peuvent (ou non) être intégrées dans des bouquets payants sans l’accord des éditeurs. Elle pourrait également clarifier l’application des règles de portabilité et les obligations contractuelles des distributeurs audiovisuels vis-à-vis des ayants droit.

 Éditorialistes & Contributeurs
Éditorialistes & Contributeurs Corporate management
Corporate management